Palestine: L’article d’Orient XXI analyse le plan du président américain Donald Trump visant à transformer la bande de Gaza en un territoire sous contrôle américain, en expulsant sa population palestinienne vers l’Égypte ou la Jordanie. Ce projet, qui prévoit de faire de Gaza une « Riviera » du M-O : est largement critiqué pour sa violation flagrante du droit international et est qualifié de nettoyage ethnique.
Les Nations Unies ont mis en garde contre toute tentative de déplacement forcé de population, rappelant que de telles actions sont strictement interdites par le droit international humanitaire. Les Palestiniens, profondément attachés à leur terre, rejetant massivement cette proposition, la considérant comme une atteinte à leurs droits fondamentaux et à leur identité nationale.
https://orientxxi.info/magazine/gaza-avec-donald-trump-en-avant-toute-vers-le-nettoyage-ethnique,7988 (publié le 04 février 2025 dans L’Orient XXI)
----
Palestine : En 2024, l'année la plus meurtrière pour les journalistes, 70 % des meurtres ont été attribués à Israël, en particulier pendant les offensives militaires à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Le rapport du Committee to Protect Journalists (CPJ) révèle que 124 journalistes ont été tués dans 18 pays, dont 85 par Israël. Ce chiffre inclut des journalistes palestiniens et libanais, avec des accusations de ciblage délibéré. Israël a été responsable d'un nombre record de décès de journalistes, alimentant des préoccupations sur l'impunité pour ces crimes.
https://www.newarab.com/news/israel-responsible-70-percent-journalist-killings-2024 ( publié le 12 février 2025 sur The new Arab)
----
Palestine : Des sources de Hamas ont indiqué que l'Égypte et le Qatar ont fourni des garanties concernant la libération des prisonniers, s'engageant à assurer le processus si Israël respectait ses engagements. L'initiative vise à améliorer la situation humanitaire et renforcer les négociations autour de la paix dans la région.
https://aawsat.com/العالم-العربي/المشرق-العربي/5111505-مصادر-حماس-لـالشرق-الأوسط-مصر-وقطر-قدمتا-ضمانات-وملتزمون-بإطلاق ( publié le 12 février 2025 sur le journal arabe Aawsat)
Syrie : L’article intitulé « La Syrie et l’opportunité d’un nouveau récit arabe », analyse les conséquences de la chute inattendue du régime Assad et de la prise de Damas par Hayaat Tahrir al-Cham. L’opinion publique arabe se réjouit de la fin d’un régime associé à la barbarie et à la connivence avec l’Iran, mais les gouvernements arabes affichent des réactions divergentes. L’Article souligne que les principales chaînes panarabes, telles qu’Al Jazeera, Al Hadath et Sky News Arabiya, proposent des récits différents, reflétant les positions de leurs gouvernements respectifs. Ces évènements remettent en question les narratifs idéologiques établis depuis les printemps arabes, notamment la division entre un camp islamo-révolutionnaire et un camp militariste anti-islamiste. L’auteur suggère que cette situation offre une opportunité pour redéfinir le récit arabe, en dépassant les anciennes divisions et en adoptant une approche plus unifiée face aux défis actuels.
https://www.lorientlejour.com/article/1443748/point-de-vue.html (publié le 16 janvier 2025 dans l’Orient -Le Jour)
Syrie : Le président russe Vladimir Poutine a échangé avec Ahmed Charaa sur la situation en Syrie, Il a proposé son aide pour soutenir la stabilité en Syrie. Il a souligné l'importance de la coopération pour restaurer la paix et renforcer les efforts diplomatiques dans la région.
https://www.aljazeera.net/news/2025/2/12/بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا (12 ( le 12 février 2025 sur Al-Jazeera)
Iran: L’article de l’Orient -Le jour, analyse la situation actuelle de l’Iran, affaibli par la perte de ses alliés régionaux et la réduction des capacités du Hezbollah. Dans ce contexte, le programme nucléaire iranien reste son principal levier stratégique. L’auteur suggère que le président américain Donald Trump a une opportunité historique de négocier un nouvel accord global avec Téhéran, incluant le programme nucléaire, les missiles balistiques et les mandataires régionaux. Un tel accord pourrait réduire le risque de prolifération nucléaire au Moyen -Orient et permettre aux USA de se concentrer sur d’autres priorités géopolitiques.
https://www.lorientlejour.com/article/1444995/nucleaire-iranien-une-nouvelle-opportunite-historique.html (publié le 25 Janvier 2025 dans l’Orient -Le Jour).
Jordanie : Le président américain Donald Trump a rencontré le roi Abdallah II de Jordanie pour discuter de l’avenir de la bande de Gaza. Trump a proposé que les Etats-Unis prennent le contrôle de Gaza après avoir déplacé sa population palestinienne vers la Jordanie et l’Égypte, avec l’intention de transformer le territoire en une zone de développement immobilier. Le roi Abdallah II a fermement rejeté cette proposition, soulignant son opposition au déplacement des Palestiniens et insistant sur la nécessité de reconstruire Gaza tout en respectant les droits des Palestiniens à rester sur leur terre, cette rencontre s’est déroulée dans un climat tendu, reflétant les divergences profondes entre les deux dirigeants sur la question palestinienne.
https://www.youtube.com/watch?v=MbT2XEuoTDc ( publié le 11 février 2025 sur France 24)
Liban : Le gouvernement de Nawaf Salam, annoncé le 8 février 2025, comprend 24 ministres, dont 5 femmes. Tarek Mitri est nommé vice-président du Conseil des ministres. Le cabinet inclut des figures politiques variées, des anciens ministres et des indépendants, mais aucun membre du gouvernement sortant. Le Courant Patriotique Libre passe dans l'opposition. Le gouvernement dispose de 30 jours pour obtenir la confiance parlementaire.
https://www.lorientlejour.com/article/1446757/qui-sont-les-ministres-du-gouvernement-de-nawaf-salam-.html ( publié le 08 février 2025 sur l’Orientlejour)
Les pays arabe face à D.Trump : Selon des analystes, les Arabes font face à un danger existentiel nécessitant une stratégie d'unité et d'innovation. Ils doivent créer des partenariats régionaux solides pour répondre aux défis géopolitiques et technologiques actuels. L’accent est mis sur l’importance de renforcer la coopération économique et sécuritaire.
https://www.aljazeera.net/news/2025/2/13/محللون-العرب-أمام-خطر-وجودي-وعليهم-خلق (publié le 13 Février 2025 sur Al Jazeera)
Algérie -France : L’article analyse l’escalade des tensions entre la France et l’Algérie, exacerbées par les positions de la droite française. Après la dissolution de l’Assemblée nationale en juin-juillet 2024, le président Emmanuel Macron, privé de majorité parlementaire, s’est tourné vers les Républicains pour former un gouvernement. Cette alliance a conduit à un rapprochement avec le Maroc et à une reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, rompant avec la position française traditionnelle en faveur de l’autodétermination. Cette décision a provoqué la colère d’Alger, qi a rappelé son ambassadeur et gelé certaines coopérations avec la France. Parallèlement, le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, a adopté une ligne dure envers l’Algérie, notamment en matière migratoire, alimentant davantage les tensions entre les deux pays.
https://orientxxi.info/magazine/algerie-france-la-droite-enflamme-les-tensions,7945 (publié le 28 janvier 2025)
Soudan : Le Soudan ne voit pas d’obstacle à l’installation d’une base navale russe sur la mer Rouge, selon son ministre des Affaires étrangères. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un accord signé avec Moscou pour renforcer la coopération militaire et la présence russe dans la région stratégique.
https://information.tv5monde.com/afrique/soudan-pas-dobstacles-une-base-navale-russe-sur-la-mer-rouge-selon-le-ministre-des-affaires ( publié le 12 février 2025 sur TV5 Monde)
Turquie : La Turquie et l'Indonésie ont signé un accord pour créer une coentreprise visant à construire une usine de drones turcs en Indonésie. Ce projet vise à renforcer la coopération dans le domaine de l'aéronautique et des technologies de défense.
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2025/2/12/تركيا-وإندونيسيا-توقعان-اتفاقية ( publié le 12 février 2025 sur Al Jazeera)
Les Émirats: Lors du sommet L’IA à Paris, les Émirats ont annoncé la construction d'un immense data center en France. Ce projet vise à renforcer l'infrastructure numérique européenne et à répondre à la demande croissante de données, tout en renforçant la coopération entre la France et les Émirats dans le secteur technologique.
https://information.tv5monde.com/economie/sommet-sur-lia-paris-les-emirats-construiront-en-france-un-data-center-geant-2761829 ( publié le 06 février 2025 sur TV5 Monde)
19 février 2025
Le monde arabe en mouvement : que se passe-t-il en ce moment ? (19 février 2025)
17 janvier 2025
De 1885 à 1907, Léopold II, le roi des Belges...
De 1885 à 1907, Léopold II, le roi des Belges, se lance dans la conquête du Congo. Appâté par l’ivoire et le caoutchouc de cette colonie dont il fait sa propriété personnelle, il la saigne à blanc. Un génocide dont l’ampleur exacte est difficile à déterminer, les estimations des historiens allant de 1 million à 10 millions de morts.
« Congo », le récit d’Eric Vuillard
Un article de la série du "Nouvel Obs" Derrière la photo (2/4)![]()
Par Doan Bui. Publié le 17 décembre 2024
Cette histoire-là, Eric Vuillard la connaissait. « Mais quelque chose dans ce cliché m’a fait réaliser que nous, Occidentaux, Blancs, nous ne pourrons jamais comprendre. Ces enfants, sur la photo, ils nous fixent de leurs yeux de papier. Comme si, par un petit trou, leur âme nous regardait. Dans leur regard, il y a une tristesse qui s’enfonce dans le cœur et qui vous fait vous sentir tout petit, vous perdre tout au fond de vous-même. » Et c’est cette tristesse, dans le regard de ces enfants qui a embarqué le romancier dans l’histoire du Congo belge.
« Congo », le récit d’Eric Vuillard, s’ouvre par la conférence de
Berlin, des mois de négociations qui commencent en 1884 pour se terminer
en 1885, un Yalta colonial où les puissances occidentales décident de
se partager l’Afrique. Car, précédant les carnages, il n’y a toujours
qu’un seul moteur : l’argent. C’est d’ailleurs pour des raisons de
rentabilité qu’il va pleuvoir des mains coupées au Congo.![]()
La « force publique » belge, bref, l’armée de Léopold II, ne fournit pas
assez de munitions aux mercenaires locaux embauchés pour mater les
populations forcées de récolter le caoutchouc. Pour justifier de leur
usage des balles, les soldats doivent ramener des « trophées », en
l’occurrence, une main coupée, souvent la droite, pour obtenir salaire.
Les « coupeurs » de main en ont parfois tant, des mains, qu’ils les
fument pour pouvoir les conserver, et les présenter aux autorités
belges.
La première campagne humanitaire médiatique
La photo des enfants mutilés provient de la collection de la missionnaire britannique Alice Seeley-Harris, envoyée au Congo en 1898. Une collection de 60 clichés qu’elle a réalisés avec son mari John Harris, ou récupérés auprès d’autres missionnaires pour dénoncer les horreurs commises sur ce territoire. Les images auraient pu rester cantonnées à la presse protestante. Sauf que les Harris ne sont pas seuls dans leur combat. Ils ont rejoint la Congo Reform Association, née en 1904, un collectif créé par Roger Casement, consul britannique au Congo, et par le journaliste Edmund Morel. Casement a écrit un rapport incendiaire sur les exactions de Léopold II, Edmund Morel, un livre non moins terrible, publié en 1904 : « King Leopold’s Rule in Africa ». Mais ce sont les photos des Harris qui lancent réellement la campagne.
Tout cela tombe très bien pour des puissances comme la France ou l’Angleterre, car ce tintamarre autour de la Belgique évite de jeter une lumière trop crue sur ce qui se passe dans leurs propres conquêtes coloniales… L’impact de ces images est en tout cas suffisamment fort pour que Léopold II soit contraint de lancer une contre-offensive. Il accuse Harris d’avoir truqué les photos », raconte l’historien Daniel Foliard, auteur de « Combattre, punir, photographier », un essai remarquable à tout point de vue sur la photographie et la violence coloniale. [1]
(...) Avant les Harris, un pasteur afro-américain, George Washington, est parti au Congo et, horrifié, a accusé Léopold II de « crimes contre l’humanité » dans une lettre ouverte : son rôle a été aujourd’hui largement oublié. Les photos des Harris, par leur large diffusion, ont invisibilisé les exactions qui se passent ailleurs, en particulier dans l’empire français. Comme s’il y avait eu des colonisations conduites « humainement ». « D’autres images d’horreurs existent pourtant, par exemple lors de la conquête française au Soudan. Mais elles n’ont pas circulé à l’époque. Elles sont totalement occultées, jusqu’à aujourd’hui, encore. Il y a une véritable aphasie coloniale française », souligne Daniel Foliard.
Pour lire la suite, et le texte entier, voir Le Nouvel Obs... et avoir le coeur bien accroché !
_____________
◗ A lire pour en savoir plus![]()
« Congo, l’histoire d’un holocauste oublié », Eric Vuillard, Actes Sud![]()
Prix Goncourt pour « l’Ordre du jour », le romancier revisite l’histoire
coloniale du Congo. Dans ce récit ramassé et saisissant, Vuillard nous
faisant découvrir ceux qui sont à la manœuvre, Léopold II, le
« pharaon » du caoutchouc, Leon Fiévez, l’administrateur colonial fou et
bien d’autres.![]()
◗ « Combattre, punir, photographier : empires coloniaux 1890-1914 », Daniel Foliard La Découverte![]()
Un ouvrage historique qui fera date. L’essai de Daniel Foliard analyse
des clichés d’archives, dont beaucoup ont été effacés de notre mémoire
collective.![]()
◗ « Au cœur des ténèbres », Joseph Conrad.![]()
Le roman culte qui a inspiré « Apocalypse Now ».![]()
◗ Mais aussi le site https://antislavery.nottingham.ac.uk/, qui a numérisé toute la collection des Harris, ainsi que les clichés des Congo Atrocity Lantern Lecture.
01 janvier 2025
Paul-Claude Racamier, le psychanalyste qui a théorisé la « perversion narcissique »,
Nouvel Obs. Publié le 22 décembre 2024, mis à jour le 24 décembre 2024
Par Anne Crignon
Extraits
Paul-Claude Racamier a notamment décrit et documenté comment cette déviance morale fait des ravages dans les lieux de pouvoir et les institutions. Portrait d’un grand nom de la psychanalyse à l’occasion du centenaire de sa naissance.
ll y a cent ans venait au monde Paul-Claude Racamier (1924-1996) qui deviendrait ce grand psychiatre épris de psychanalyse, et vice versa, arpenteur, dirait-il, des « plus étranges contrées de la psyché » – et des plus ténébreuses. La postérité, qui trie à la va-vite, n’a pas gratifié d’une renommée à la hauteur de son génie ce chercheur qui mit en circulation, entre autres concepts, celui du très populaire « perversion narcissique ».
Au jour de définir dans son œuvre cette déviance morale, Paul-Claude Racamier commença par quelques mots désolés, comme pour s’excuser d’avance de produire un si sombre constat : « Je dois maintenant m’acquitter du devoir d’introduire la partie la plus amère de cet ouvrage. »
1952. Sa rencontre avec Francis Pasche, thérapeute influent de son temps, ouvre à Paul-Claude Racamier les portes de la Société de Psychanalyse de Paris, la SPP, dont il sera membre bientôt. Les murs résonnent d’absurdes querelles. Lui s’offre juste le luxe de dire non à Jacques Lacan. (...)
Cette défiance vis-à-vis du roi Lacan ajoutée à son horreur des lieux de pouvoir et des fausses amitiés pourtant utiles à la construction d’une carrière lui valent sans doute la chape d’oubli posée sur son cercueil.
(…) Puisant dans sa phénoménale connaissance des travaux de Freud, il estime que « l’Œdipe » du maître souffre d’incomplétude. Il propose de lui associer « l’Antœdipe » (en gros : organisation psychique qui prélude à l’Œdipe et l’accompagne), selon lui, « rien n’est d’inventé qui ne préexiste »). Il espère que ce concept entrera un jour au répertoire commun et sera d’utilité publique sans être pour autant « galvaudé » et « défiguré ». Facétie du destin, c’est une autre de ses découvertes qui connaîtra semblable destin : la perversion narcissique. Car, déjà, il scrute tout ce qui relève du sujet. Identité narcissique, capacité narcissique, déficience narcissique, survie narcissique, assistance narcissique, perfusion narcissique, défense narcissique : la machine est lancée.
La Velotte, l’ancêtre des hôpitaux de jour
En 1967, pas mécontent de s’éloigner de Paris et des mesquineries à la Société de Psychanalyse, où il n’ira plus que par intermittence, Paul-Claude Racamier ouvre à Besançon une petite institution de cette taille humaine essentielle à ses yeux : c’est La Velotte, considérée comme l’ancêtre des hôpitaux de jour, toujours ouverte aujourd’hui, toujours singulière. On y encourage d’emblée la coopération des familles dans une ambiance « comme à la maison » – le « vert-Racamier » posé sur les murs en est un signe amusant. La pratique est ici, hier comme aujourd’hui, en accord avec la pensée de son hôte : « La médecine psychosomatique a montré chaque jour qu’on n’est pas tuberculeux qu’avec des bacilles de Koch dans ses poumons. En réalité, l’histoire d’un homme avec ses agressions, ses désirs, et ses amertumes se cache et se place dans la paroi gastrique ou dans ses alvéoles immunitaires tout comme elle peut se dire et se taire à la fois dans les symptômes de sa névrose. »
A La Velotte, devenue l’arche de Racamier en somme, et qui obtiendra en 1983 l’agrément de la Sécurité sociale, il poursuit sa réflexion sur « l’esprit des soins » – ce sera d’ailleurs le titre d’un ouvrage publié à titre posthume. Il voit le psychiatre-psychanalyste comme un « chef d’orchestre » conduisant ensemble de sa baguette avisée soin aux patients, soin aux soignants, soin à l’institution, soin aux familles. Lui est d’une rare disponibilité. Un infirmier en difficulté peut lui téléphoner à toute heure du jour ou de la nuit (…).
Jour après jour, Racamier approfondit sa recherche sur la schizophrénie dont il est spécialiste (son livre sur le sujet est un classique) et continue de travailler sur les perversions narcissiques – le pluriel a son importance comme on va le voir. Au départ, il appelle « porteurs d’une perversion de caractère » les gens qui envisagent autrui comme un ustensile au service de l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Au cours d’une carrière à dimension internationale, il observe ce mal dans plusieurs hauts lieux de la psychanalyse et se blesse lui-même au contact de ce genre de personnages, comme un infirmier-chef en Suisse particulièrement toxique. Il dira avoir « côtoyé l’indicible ».
Il y a un bon côté à ces mauvaises rencontres. Plus rien ne lui échappe du phénomène complexe d’expulsion ou tentative d’expulsion par un sujet de ses propres désordres psychiques pour les faire couver chez autrui. Terrible réalité que la vidange d’une psyché malade avec éjection des souillures dans la psyché d’un autre devenue une poubelle. Il nomme « Porte-faix » (un autre concept) toute personne ainsi agressée, violée pourrait-on dire si le viol psychique existe. L’affaire est grave. Paul-Claude Racamier est en train d’identifier et de mettre au jour la préoccupation inconsciente, constante, féroce de certains (et certaines bien sûr) de faire couver par autrui une dépression ou une psychose afin de l’éviter pour soi-même et la possibilité de déménager ainsi jusqu’aux pulsions suicidaires. La perversion narcissique est une forme d’économie. En présentant la note à un autre, le porteur fait l’économie de la souffrance, l’économie de la remise en question, l’économie du long travail de compréhension et de connaissance de soi, l’économie des remords et regrets qui accompagnent ce cheminement, et on en oublie sans doute. D’éminents successeurs comme Maurice Hurni et Giovanna Stoll qui ont travaillé (remarquablement) sur le couple de pervers, viendront plus tard ajouter leur coup de pinceau au tableau avec d’autres concepts telle la « crise de fureur narcissique » (s’observe sur le sujet que seule la blessure de nature narcissique affecte). Une association, Autour de l’œuvre de Racamier, où sont quelques-uns de ses amis d’antan comme Jean-Pierre Caillot, continue aujourd’hui d’actualiser et diffuser les connaissances.
Un « psychanalyste sans divan »
L’écriture de ce « psychanalyste sans divan » (titre d’un de ses livres) est limpide, rigoureuse. Vivante aussi, avec un soin porté au juste mot. Certains ont suggéré qu’elle était un « contre-style » à opposer à celui de Lacan. « Après tant de pages écrites dans un sabir brumeux, tu nous fais entrer au musée de la transparence », déclara un confrère et ami au cours d’un colloque. Voilà qui lui valait sans doute pas mal d’inimitié. Qu’importe, le meilleur restait à venir : « le Génie des origines » (Payot, 1992) où il décrit, chapitre 9, les contours précis de la perversion narcissique. Aux Etats-Unis, un grand homme est d’accord avec lui, Harold Searles, auteur d’un ouvrage paru en 1978 dont le titre résume à lui seul la torsion perverse : « l’Effort pour rendre l’autre fou ».
Ce mal peut être passager. C’est le « soulèvement pervers » (concept) ou bien installé, susceptible d’être porté à un très haut niveau « d’accomplissement » (lu dans ses descriptions). Au calcul et à l’action prédatrice, il oppose l’intelligence créatrice qui est la cible de prédilection du pervers, et rédige ceci, de nos jours en circulation sur internet (quoique moins bien formulé) : « ll n’y a rien à attendre de la fréquentation des pervers narcissiques, on peut seulement espérer s’en sortir indemne. » Ce que l’on sait moins c’est que l’inventeur de la perversion narcissique avait aussi inititié une réflexion sur les groupes et les institutions gagnés par ce mal.
A côté de la perversion narcissique d’ordre privée ou professionnelle, il y a la perversion institutionnelle. Mais alors, l’institution Vᵉ République, en son pitoyable état, serait-elle l’objet d’une offensive perverse impossible à nommer ? Et le travail de Racamier de nature à éclairer la scène politique à l’heure où le mot « chaos » est partout prononcé ?
(…) La perversion institutionnelle, elle, se reconnaît au « délitement de la pensée vraie, profonde, écrit Racamier. La pensée perverse est une pensée créativement nulle et socialement dangereuse. Elle peut être considérée comme le modèle de l’antipensée (…) On a vu des groupes se déliter, des institutions pourrir, et des peuples entiers souffrir sous l’emprise de la pensée perverse exercée et mise en œuvre par quelques-uns. »
Et d’ajouter : « Quel est, au fait, le véritable secret de cette “pensée” ? C’est une pensée pour ne pas penser. » Il décrit aussi le « profond cachet d’inauthenticité » du pervers, et la parole utilisée comme une arme : « Le terrain de prédilection, l’instrument majeur de la perversion narcissique, il est temps de le dire, c’est la parole. (On l’aura compris : je ne prétends pas que l’exercice de la parole n’appartienne qu’à des pervers). » Quant à la « mystérieuse innocence » des faiseurs de zizanie, elle s’explique par ce « verrouillage défensif » (concept) qu’est le déni.
Imaginons maintenant un pays qui porterait à la tête de l’Etat un tel personnage. On irait alors étudier cette mise en garde postée par Racamier au siècle dernier au sujet de ce qu’il appelle la « mise à feu » : « Nous n’avons pas regardé ce qui se passe lorsque cette perversion, sous la pression d’une formidable accélération, touche à la folie. Comment s’effectue la mise à feu ? Ce n’est pas sous le coup de l’échec, mais au contraire sous l’emprise de la réussite. Cette réussite consiste elle-même dans la réalisation d’une ambition majeure du sujet. II convoitait ardemment une fonction à ses yeux prestigieuse : il l’obtient. Un titre : on le lui donne. Un grade : il l’atteint. Un lot : il le gagne (…) Voilà donc une réussite qui est prête à précipiter une pathologie (…) C’est le succès qui enivre le narcissique pervers ; c’est la réussite qui lui donne des ailes et lui ôte toute retenue, commence alors un formidable processus d’accélération. Une image vient irrésistiblement à l’esprit : celle du feu qui propulse. Le moi se met à flamber (…) La folie narcissique atteint son comble ; deux mots suffiront à la définir : une mégalomanie maligne. Rien ne semble arrêter le triomphe narcissique, l’élévation domine tout : le sujet se sent irrésistible, il vit dans le triomphe et le défi. Il défierait le monde entier ».
On voit quelle découverte considérable fit Paul-Claude Racamier lorsqu’il prit conscience que rien n’est blessable davantage qu’un narcissisme sain attaqué par un narcissime pervers. Etonnamment (…) on trouva ceci parmi les dernières notes maladroites jetées sur papier par le psychanalyste à la veille de mourir, le 18 août 1996, tracé de son ample écriture :
“ « Je le savais. Plus que jamais, je l’ai senti. Décidément le narcissisme pathologique fait mal au narcissisme normal. »”
« Je le savais. Plus que jamais, je l’ai senti. Décidément le narcissisme pathologique fait mal au narcissisme normal. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Claude_Racamier
à lire, (pour les abonnés au Nouvel Obs) : https://www.nouvelobs.com/histoire/20241222.OBS98142/paul-claude-racamier-le-psychanalyste-qui-a-theorise-la-perversion-narcissique-prive-de-posterite-pour-avoir-defie-lacan.html
_________________
Paul-Claude Racamier. SOCIETE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
https://www.perspectives-psy.org/articles/ppsy/full_html/2012/03/ppsy2012513p213/ppsy2012513p213-img1.gif
04 décembre 2023
Polémiques et mise au point suite au livre "De guerre en guerre" d'EdgarMorin
1. Polémiques suite au livre "De guerre en guerre" d'Edgar Morin
2. Et la réaction : une mise au point d'Alain Refalo![]()
 Il était prévisible que le point de vue d’EdgarMorin allait susciter des polémiques.
Il était prévisible que le point de vue d’EdgarMorin allait susciter des polémiques.
Et ce n’a pas manqué !![]()
Notamment dans Le Monde, on a pu lire, en janvier 2023, cet article : ![]()
« De guerre en guerre. De 1940 à l’Ukraine » : Edgar Morin se trompe de combat
"Dans le nouvel essai du sociologue, d’importantes erreurs factuelles grèvent l’analyse du conflit en cours."![]()
Par Florent Georgesco
Publié le 12 janvier 2023, modifié le 08 juillet 2023.
En voici le début :
"Nul ne pourrait reprocher à un vieux savant, auteur d’une œuvre sociologique et philosophique abondante, qui a touché aux sujets les plus divers, de ne plus avoir, à 101 ans, l’énergie et la curiosité de se consacrer avec rigueur à de nouveaux domaines. Mais alors le bon sens voudrait qu’il n’écrive pas de livres sur ces sujets laissés en plan. C’est pourtant ce que vient de faire Edgar Morin à propos de l’Ukraine en publiant De guerre en guerre, et le résultat laisse perplexe.
Le projet auquel répond ce petit livre en vaut a priori un autre. L’auteur de La Rumeur d’Orléans (Seuil, 1969) entend mettre les événements ukrainiens en perspective à partir de son expérience de la guerre, fondée sur son engagement dans la Résistance et quatre-vingts ans d’observation des crises mondiales. Il veut avertir contre les mécanismes de « radicalisation » qu’entraînerait, selon lui, toute guerre. Au premier chef, une « hystérisation » réciproque, qui pousserait à développer un « manichéisme » empêchant de se livrer à une « contextualisation » adéquate.
Comment, cependant, contextualiser sans connaître ? Passé cette leçon de choses guerrières, Edgar Morin en vient à la situation particulière de l’Ukraine, et les inexactitudes sur l’histoire et l’actualité se multiplient. Affirmer que l’Ukraine « proclama son indépendance », après la révolution d’Octobre, « sous la conduite de l’anarchiste Makhno » n’a par exemple aucun sens. C’est la Rada (le Parlement ukrainien) qui, le 22 janvier 1918, a proclamé l’indépendance, fruit d’un processus collectif sur lequel Makhno n’avait pas pesé. (…)
Lire la suite sur https://www.lemonde.fr/livres/article/2023/01/12/de-guerre-en-guerre-de-1940-a-l-ukraine-edgar-morin-se-trompe-de-combat_6157642_3260.html
Et la réaction : une mise au point d'Alain Refalo
Militant de la non-violence et de l’écologie depuis 35 ans, cofondateur du Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées (en 2003). Professeur des écoles depuis 1990, Initiateur, en octobre 2008, du mouvement des enseignants-désobéisseurs du primaire pour résister aux attaques portées contre l’école de la République. https://alainrefalo.blog/
Le “parti poutinien s’est réveillé en France”, voici comment quelques articles à charge ont salué ce livre en témoignant du fait qu’il n’y avait plus pour ces gens-là (le parti de l’OTAN) le moindre espace de débat d’idées. Sans être même en guerre, le parti de l’OTAN, sa censure, en sont à ressusciter l’index Vatican : : si vous êtes contre la guerre, vous êtes “poutinien”, le mal. En considérant les individus désignés à la vindicte publique, j’ai pensé que le fait d’être juif, surtout si on est athée, peut parfois favoriser un certain courage face à tous les négationnismes. En effet si dans le parti “poutinien”, est-ce un hasard si c’est un descendant de Nizan (Todd), Arno Karsfeld, et maintenant Edgard Morin qui s’élèvent contre la manière dont le bellicisme occidental met ses pas dans ceux du nazisme ? En matière de réhabilitation du nazisme, il n’y a pas que l’Ukraine où l’on constate d’étranges complaisances, la réhabilitation y compris en Amérique latine et même en Yougoslavie, en Pologne est allée loin derrière l’OTAN et les USA. Déjà plutôt que de répondre à des faits, comme nous l’avons expérimenté nous-mêmes, le parti de l’OTAN, le négationnisme sans frein, a trouvé sa réponse : le parti “poutinien” se réveillerait. Quelle honte, d’abord aller jusqu’à nier des faits manifestes, ensuite de s’attaquer ainsi à l’honneur de ceux qui osent dans ce consensus indigne défendre leur refus de la guerre, du racisme, de la xénophobie.(...)
08.01.23 – Paris, France – Alain Refalo
https://histoireetsociete.com/2023/01/16/de-guerre-en-guerre-dedgar-morin/
Edgar Morin, que l’on ne présente plus, 101 ans, publie ces jours-ci un livre décapant sur la guerre, plus exactement sur les guerres, celle qu’il a vécue et celle d’aujourd’hui. Résistant, ayant combattu les armes à la main le nazisme, on ne suspectera donc pas le célèbre sociologue et philosophe d’être un « pacifiste », appellation péjorative inlassablement reprise pour discréditer toute personne qui s’élève contre les horreurs de la guerre ou tout simplement contre toute guerre. Et pourtant, ce livre, écrit dans un style incisif, bourré de références historiques précises, est un véritable plaidoyer contre la guerre, celles du passé comme celles du présent, et surtout contre celle, mondiale, qui risque d’advenir.
Son récit commence par rappeler le bombardement par l’armée allemande de la ville de Rotterdam auquel ont répondu, au nom de la lutte contre l’ordre nazi, les bombardements de plusieurs villes allemandes, faisant des centaines de milliers de morts. Il précise que « lors du débarquement allié en Normandie, soixante pour cent des morts civiles normandes furent dues aux bombardements libérateurs. C’est bien plus tard, précise-t-il, – depuis l’invasion de l’Ukraine – que monta en moi la conscience de la barbarie des bombardements accomplis au nom de la civilisation contre la barbarie nazie ». Pour ma part, c’est la première fois que j’entends un penseur français dénoncer la « barbarie » des bombardements des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Edgar Morin considère qu’il s’agit bien là de « crimes de guerre systémiques ». Ce qui l’amène à conclure que « si juste que fut la Résistance au nazisme, la guerre du Bien comporta du Mal en elle. »
Remontant dans le temps, Morin évoque « l’hystérie de guerre » survenue durant la Première Guerre mondiale, constituée de « la haine de l’ennemi et de sa totale criminalisation ». Il remarque que « le mensonge de guerre est l’un des aspects les plus odieux de la propagande de guerre ». Passant en revue quelques-uns de ces mensonges de l’Histoire, en URSS et en Chine, Morin ne peut que constater que « toute guerre, y compris l’actuelle, favorise des mensonges de guerre plus ou moins énormes ».
Son indignation se veut plus insistante quand il dénonce la criminalisation de tout un peuple que l’on retrouve en période de guerre. Il précise qu’il a « toujours rédigé des tracts clandestins antinazis, jamais antiallemands ou antiboches ». Cette criminalisation est un fait marquant et continu de l’histoire des nations en guerre. Elle entraîne les pires crimes contre les civils commis par des soldats, en toute légitimité et en toute impunité. Morin est catégorique : « Toute guerre, de par sa nature, de par l’hystérie qu’entretiennent gouvernants et médias, de par la propagande unilatérale et souvent mensongère, comporte en elle une criminalité qui déborde l’action strictement militaire ». C’est ce que les « pacifistes » ont toujours dit…
Morin n’est pas en reste avec la guerre actuelle. S’il condamne les manipulations, les mensonges et les crimes de guerre commis par les Russes en Ukraine, il remarque qu’en Ukraine, « la prohibition de la littérature russe, Pouchkine, Tolstoï, Dostoïevski, Tchekov, Soljenitsyne compris, est un signe très alarmant d’une haine de guerre non seulement contre un peuple, mais également contre sa culture ». Notre solidarité avec l’Ukraine ne doit pas nous aveugler, au point d’occulter les mensonges et les manipulations à l’œuvre aussi dans ce pays agressé.
Edgar Morin poursuit son regard sur les guerres passées et présentes en soulignant son expérience des « radicalisations qui ont déclenché le pire des atrocités de guerre et se sont terminées par les issues les plus tragiques ». Que ce soit en ex-Yougoslavie ou en Palestine, il montre que la radicalisation est indissociable de la criminalisation qui ne peut qu’engendrer des horreurs incommensurables. Tout particulièrement, il évoque la guerre d’Algérie, en précisant le rôle historique de la France dans le déclenchement des évènements et leurs développements meurtriers jusqu’à aujourd’hui. En Ukraine, selon Morin, les mêmes processus sont à l’œuvre faisant craindre « une nouvelle guerre mondiale ».
Dans son analyse de l’histoire récente de l’Ukraine, Morin est bien obligé de constater les parts d’ombre qui existent dans les choix effectués par les dirigeants ukrainiens, souvent sous l’influence grandissante des États-Unis. Ainsi comment ne pas être choqué par la décision de la municipalité de Kiev, après la révolution de 2014, de débaptiser l’avenue « de Moscou » pour l’appeler avenue « Bandera », du nom du nationaliste ukrainien qui approuva l’extermination des Juifs de Kiev en 1941. Aujourd’hui encore, Edgar Morin remarque qu’il existe « une complaisance au banderisme, et surtout une hystérie hypernationaliste antirusse qui a prohibé la langue, la littérature, la musique russes ».
Son livre se termine par un vigoureux plaidoyer pour la paix, avec des accents qui rappellent les exhortations lucides de Camus durant la guerre d’Algérie. Il s’étonne d’ailleurs que « si peu de voix s’élèvent dans les nations les plus exposées, en premier lieu européennes, en faveur de la paix ». Edgar Morin est particulièrement sévère envers ceux qui font la guerre par procuration, en livrant des armes, tout en étant sûr qu’elle ne les affectera pas sur leur sol. « Parler de cessez-le-feu, de négociations, est dénoncé comme une ignominieuse capitulation par les belliqueux, qui encouragent la guerre qu’ils veulent à tout prix éviter chez eux ». La négociation est désormais une priorité. D’ailleurs, Morin voit des signes de « réalisme » des deux côtés, y compris chez Poutine.
« J’ai écrit ce texte pour que ces leçons de quatre-vingt années d’histoire puissent nous servir à affronter le présent en toute lucidité, comprendre l’urgence de travailler à la paix, et éviter la tragédie d’une nouvelle guerre mondiale », nous dit Edgar Morin dans son ouvrage. C’est un livre éminemment pédagogique, autant pour les jeunes générations que les anciennes. Edgar Morin propose un regard neuf, original et salvateur sur la guerre en Ukraine à l’aune de sa propre expérience, de ses recherches, de sa grille de lecture toujours aussi féconde. Loin de la pensée unique qui s’exprime dans les médias toujours préoccupés de commenter la guerre « en direct », Morin, avec tout le recul nécessaire, nous invite à décentrer notre regard pour voir autrement l’événement qui s’inscrit dans une continuité historique qu’il expose avec brio.
On ne peut donc que conseiller la lecture de cet ouvrage, ni pessimiste, ni optimiste, mais profondément réaliste. Il y a urgence, clame Morin : « Cette guerre provoque une crise considérable qui aggrave et aggravera toutes les autres énormes crises du siècle ». La paix dans la justice, dans la reconnaissance mutuelle, tel est le combat prioritaire d’aujourd’hui. Car « plus la guerre s’aggrave, plus la paix est difficile, plus elle est urgente ». Comme Romain Rolland en son temps, Edgar Morin se situe au-delà de toutes les haines pour penser un avenir délivré de la malédiction de la guerre. Il nous invite à agir lucidement et vigoureusement en faveur d’une paix juste et durable en Europe.
https://agirpourlapaix.be/de-guerre-en-guerre-dedgar-morin/
Alain Refalo![]()
Militant de la non-violence et de l’écologie depuis 35 ans,
cofondateur du Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées
(en 2003). Professeur des écoles depuis 1990, Initiateur, en octobre
2008, du mouvement des enseignants-désobéisseurs du primaire pour
résister aux attaques portées contre l’école de la République. https://alainrefalo.blog/
L’article original est accessible ici![]()
https://alainrefalo.blog/2023/01/08/de-guerre-en-guerre-dedgar-morin/
Non-violence, Ecologie et Résistances![]()
Blog coordonné par Alain Refalo
04 novembre 2023
EDGAR MORIN : DE GUERRE EN GUERRE
Le
dernier petit livre écrit par Edgar Morin, âgé de 102 ans, est bien
intéressant. Clair, simple et précis, il précise la vision du monde des
guerres de ce siècle, depuis 1940 et même avant.![]()
Nuancé et néanmoins fondé sur une idée de la Paix qui a toujours été la sienne, malgré de multiples aléas.![]()
Le chapitre sur l’Ukraine m’apporte un éclairage que je n’ai pu lire nulle part ailleurs.
Aussi, je le reprends ici en entier. J’y ajoute une réplique polémique, et la mise au point de Alain Refalo, militant de la non-violence et de l’écologie depuis 35 ans, cofondateur du Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. [1]
- Ukraine
- La guerre
Et la réaction… Voir l'article ci-joint
L’analyse d’Edgar Morin s’arrête en 2022. Nulle doute que son point de vue resterait salutaire pour la suite des événements en Ukraine, comme au Moyen-Orient.
Comme c’était prévisible, le point de vue d’EdgarMorin a suscité des
polémiques, particulièrement en France, ce pays des couteaux tirés…![]()
C’est ainsi que dans Le Monde, on a pu lire, en janvier 2023, cet article : ![]()
"« De guerre en guerre. De 1940 à l’Ukraine » : Edgar Morin se trompe de combat”
Et puis on trouvera tout de suite la réplique, émanant d’un auteur militant de la non-violence. Les opposants, qui traitent Edgar Morin de ”poutiniste” (”le parti poutinien s’est réveillé en France”) sont identifiés comme ”le parti de l’OTAN” pour lesquels ”il n’y a plus le moindre espace de débat d’idées”.
sur le Blog "Non-violence, Ecologie et Résistances".
Vous avez dit polémique ?![]()
A chacun de juger…
1. EDGAR MORIN : DE GUERRE EN GUERRE
(Extrait, p. 63 à 76, 85)
La dialectique des relations Etats-Unis Russie
(...)
Dès la fin du siècle dernier et au cours des deux premières décennies de notre siècle, la position ukrainienne devient oscillante et incertaine, soumise à des élections souvent pro-occidentales, parfois prorusses ; la situation géopolitique et l’importance économique de l’Ukraine en feraient une prise capitale pour la Russie, dont elle serait en même temps bouclier, comme pour les États-Unis, à qui elles conféreraient une influence au flanc même de son adversaire.
C’est dans ce contexte qu’intervient la révolution pro-occidentale de Maidan, qui suscite immédiatement la sécession prorusse d’une partie du Donbass l’annexion de la Crimée par la Russie et une guerre interne permanente entre la province séparatiste de l’Est et le pouvoir ukrainien.
• Ukraine
L’Ukraine est une nation qui a la même origine que la Russie, mais qui s’est trouvée historiquement dépecée entre la Pologne, l’Empire autrichien, puis intégrée pour une grande part à la Russie tsariste. Elle a gardé sa langue propre, voisine du russe, et comme dans d’autres nations asservies, des intellectuels suscitèrent au XIXe siècle un courant indépendantiste.
Au cours des désordres et des guerres qui suivirent la révolution d’Octobre, l’Ukraine, sous la conduite de l’anarchiste Makhno, proclama son indépendance, mais fut conquise par les bolcheviks et incorporée dans l’URSS.
L’URSS laissa s’exprimer sa langue et son folklore, mais y réprima toute velléité d’autonomie. La riche terre d’Ukraine fut la principale victime de la kolkhozification forcée, de la déportation en masse des koulaks et surtout de la gigantesque famine de 1931. D’où un énorme ressentiment à l’égard de la Russie, ce qui explique les applaudissements, filmés par les nazis, d’une partie des habitants de Kiev à l’arrivée de la Wehrmacht.
Mais le plus grave fut que le mouvement indépendantiste ukrainien, exilé en Allemagne, s’était lié au pouvoir nazi sous la direction de Bandera, puis coopéra avec la Wehrmacht dans l’invasion de l’Ukraine et son occupation. Il constitua une administration aux ordres des nazis et participa aux exactions de l’occupant, y compris au massacre des Juifs. Vassili Grossman exprima sa douleur quand il apprit, à la libération de l’Ukraine des nazis, que sa mère vait été tuée par des Ukrainiens. Comme le rapporte Serge Klarsfeld, la devise des nationalistes ukrainiens collaborateurs des nazis de Bandera affichée dans les rues de Kiev en 1941 était : Tes ennemis sont la Russie, la Pologne et les Youpins. Bandera proclama même en 1941, sous l’occupation de la Wehrmacht, une « République ukrainienne indépendante ». Il y eut des engagements militaires ukrainiens dans la Légion ukrainienne ; l’UP A (Armée insurrectionnelle ukrainienne.) continua à combattre l’armée rouge après la guerre, jusqu’à son anéantissement en 1954. Il faut dire par contre que des milliers d’Ukrainiens s’enrôlèrent comme partisans contre l’occupant allemand.
Aussi on comprend que les volontaires étrangers qui s’engagent pour l’Ukraine en 2022 soient de deux types, le premier étant animé par l’idéal démocratique, le second, par l’idéal fasciste.
L’Ukraine est indépendante depuis 1991, suite à la dislocation de l’URSS ; c’est une nation extrêmement riche en terres céréalières, en ressources minières et industrielles. Dès le XIXe siècle, la Russie tsariste l’industrialisa ; au xx" siècle, l’Union soviétique installa dans le Donbass son industrie lourde, ses centrales nucléaires et peupla cette région d’ouvriers, de déportés, d’ingénieurs russes. L’Ukraine indépendante a bénéficié de cet héritage russe et a donc poursuivi son développement technoéconomique.
Si la Russie est l’agresseur évident mû par la volonté d’appropriation, et si son comportement est particulièrement destructeur sur personnes, biens et édifices, les États-Unis sont, depuis Maidan, inspirateurs de la politique ukrainienne, présents dans son économie, tout en lui fournissant l’aide précieuse de son système d’information et de renseignement.
Avec sa situation géopolitique stratégique proche de la Russie et son patrimoine économique, l’Ukraine est une proie d’importance, aussi bien pour la Russie poutinienne qui entretient le rêve de reconstituer l’Empire slave, que pour les États-Unis qui installeraient ainsi l’OTAN aux frontières occidentales de la Russie. En fait, l’Ukraine est l’enjeu de deux volontés impériales - l’une qui veut sauvegarder sa domination sur le monde slave et se protéger d’une nation voisine qui soit sous l’influence des États-Unis, l’autre qui tient à intégrer l’Ukraine à l’Occident et à enlever à la Russie son titre de superpuissance mondiale. Les États-Unis, en affaiblissant durablement la Russie par Ukraine interposée, élimineraient un des obstacles au maintien de son hégémonie planétaire, l’autre étant la Chine.
L’Ukraine indépendante a beaucoup évolué. Elle s’est urbanisée et les mœurs se sont occidentalisées. L’antijudaïsme populaire s’est atténué, peut-être au profit de l’antirussisme.
Le national-socialisme ukrainien constitue une minorité. Le banderisme y est certes exalté, mais comme indépendantisme à l’égard de la Russie et non comme auxiliaire de l’occupation allemande.
De même qu’en Russie, la dénationalisation générale de l’économie a profité à une caste d’oligarques, et la corruption s’est partout répandue.
Depuis l’indépendance, il y a eu alternance de gouvernements prorusses et pro-occidentaux, avec une première révolution « orange », démocratique et pro-occidentale en 2005 ; ensuite, dans une suite d’élections diversement truquées, l’Ukraine envisagea une association avec l’Union européenne, puis y renonça en 2013 sous la pression russe.
En fait, derrière la succession des présidents russophiles et occidentalophiles, c’est un conflit capital qui se joue, non seulement entre démocratie occidentalisée et despotisme russe, mais aussi entre impérialisme américain et impérialisme russe.
La révolution démocratique prooccidentale de la place Maidan, en 2014, à Kiev, renverse le président prorusse Viktor Ianoukovitch et renforce la tendance à se délivrer de la tutelle russe, mais déclenche la sécession des régions russophones du Donbass et l’annexion de la Crimée par la Russie. Les accords de Minsk de 2015 entre la Russie et l’Ukraine, sous l’égide des principaux pays occidentaux, ne réussissent pas à mettre fin à la guerre qui oppose les armées ukrainiennes aux forces séparatistes ravitaillées et soutenues par la Russie. Les accords de Minsk n’ont été respectés ni par l’Ukraine ni par la Russie, et la guerre a continué sur le front du Donbass, faisant quatorze mille morts jusqu’en 2022. Cette guerre ininterrompue est un véritable abcès qui est devenu purulent et a répandu son infection.
Il était donc prévisible - ce que j’ai annoncé dans un article de 2014 -, que tout conduise à une situation explosive.
Le 20 septembre 2019, le candidat antiparti V olodymyr Zelensky est élu président ukrainien, alors que sa judéité est connue, non seulement grâce à sa popularité de comédien, mais surtout par son hostilité aux partis et son programme contre la corruption.
Maidan fut un éveil démocratique, mais le banderisme y fut exalté. Comme le rappelle également Serge Klarsfeld :
Une des premières mesures de la municipalité de Kiev après la révolution de 2014 a été de débaptiser la longue avenue qui mène au site de Babi Yar, et qui portait le nom d’avenue de Moscou, pour l’appeler avenue Bandera, dont les fidèles ont assisté les nazis dans l’extermination de plus de 30 000 juifs, hommes, femmes et enfants dans le ravin de Babi Yar, les 29 et 30 septembre 1941, lorsque les troupes allemandes accompagnées des Einsatzgruppen sont entrées à Kiev.
Le tribunal administratif du district de Kiev avait ordonné à la municipalité d’annuler le changement de nom de deux rues principales au profit de Stepan Bandera et Roman Shukhevych, qui lui aussi était un massacreur de Juifs, et dont un stade porte le nom dans la grande ville de T ernopil. Mais le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a fait appel de la décision et la cour d’appel lui a donné raison. À Lviv, il y a encore deux ans des centaines d’hommes ont défilé en uniforme SS de collaborateurs ukrainiens lors d’un événement approuvé par la ville. Ces dernières années, au moins trois municipalités ukrainiennes ont dévoilé des statues pour l’adjoint de Bandera, Yaroslav Stetsko, qui, pendant la Shoah, approuvait « l’extermination des Juifs »
(Arno Klarsfeld, « L’Ukraine ne doit plus glorifier les nationalistes qui ont collaboré », Le Point, 11 septembre 2022).
Ajoutons qu’il subsiste une minorité active de nationaux-socialistes ukrainiens, dont le commandement du régiment Azov, qui s’est illustré dans la guerre civile du Donbass puis dans la défense épique d’ Azovstal, à Marioupol.
Le pouvoir ukrainien fait feu de tout bois et utilise dans sa guerre les services de ces ennemis acharnés de la Russie, mais ne peut être identifié à eux.
Il reste une complaisance au banderisme, et surtout une hystérie hypernationaliste antirusse qui a prohibé la langue, la littérature, la musique russes - la haine de la culture des peuples ennemis a été un des traits de l’hystérie de guerre de l’ Allemagne aussi.
L’Ukraine est une proie géopolitique et économique entre deux titans, vu ses · richesses considérables, notamment industrielles et minières dans le Donbass, énergétiques dans les centrales nucléaires géantes construites par l’Union soviétique.
L’Ukraine s’est réarmée depuis 2014 ; elle a bénéficié de l’aide technique et informatique des États-Unis, mais aussi en armements et en entraînement. Il y a ainsi l’influence croissante des États-Unis sur l’Ukraine, non seulement comme fournisseurs de subsides et d’armes, mais comme contrôleurs des services d’information et de renseignement, prise de possession économique, en particulier sur une partie des terres fertiles du tchernoziom. La mainmise américaine s’accroît avec l’aide économique et militaire, qui rend l’Ukraine de plus en plus dépendante de la puissance qui soutient son indépendance.
On peut supposer que sous l’emprise américaine, dont le but affirmé est « d’affaiblir durablement la Russie », le président Zelensky, qui dans un premier temps reconnaissait que la seule solution au conflit était diplomatique, devienne de plus en plus intransigeant et voie comme seule solution « la victoire ».
Sa complexité bien considérée, il est évident que l’Ukraine doit être soutenue dans son indépendance et sa souveraineté nationale.
L’Ukraine s’est renforcée alors que Poutine l’a crue divisée et affaiblie avec à sa tête un comédien devenu président ; il a cru que sa composition ethniquement duelle en faisait une entité fragile. Il savait aussi que les États-Unis, retirés d’Afghanistan, ne pouvaient envisager une nouvelle aventure militaire au loin ; plus encore, le président Biden déclara officiellement qu’en cas de guerre, les États-Unis n’interviendraient pas en Ukraine. Cette déclaration a sans doute contribué à décider Poutine à envahir l’Ukraine. On peut se demander si Biden en fut conscient lors de sa déclaration.
En somme : . si la Russie poutinienne est l’auteur de cette guerre,
c’est au terme d’un processus de radicalisation réciproque ; Poutine a
vu que les nations de l’Union européenne étaient divisées et il les a
cru affaiblies par leurs mœurs « féminisées » que méprise son virilisme.
Aussi, après avoir annexé la Crimée, péninsule tatare russifiée, en
2014, et armé les « Républiques » sécessionnistes de l’Est-Ukraine
depuis 2014, il a lancé son offensive en 2022, sûr de pouvoir décapiter
son pouvoir exécutif et d’obtenir la reddition de ses armées. ![]()
L’invasion de l’Ukraine et son extrême brutalité ont semé la crainte
d’une hégémonie russe sur l’Europe du Nord, elle a incité les pays
baltes et la Suède à entrer dans l’Otan, elle a suscité chez Ursula von
der Leyen, présidente de la Communauté européenne, le soutien intégral
aux demandes du président Zelensky, déclenché l’aide économique et
militaire des nations européennes, totalement ralliées au soutien
inconditionnel au président ukrainien, et elle a provoqué l’adoption de
sanctions contre la Russie.
• La guerre
Il y a trois guerres en une : la continuation de la guerre interne entre pouvoir ukrainien et province séparatiste, la guerre russo-ukrainenne, et une guerre politicoéconomique internationalisée antirusse de l’Occident animée par les États-Unis.
Pour une fois, le prévisible s’est réalisé : dès 2014, j’étais de ceux qui voyaient une catastrophe se profiler ; dès fin 2019, les services de renseignement américains avaient signalé que les concentrations de troupes à la frontière ukrainienne annonçaient une offensive. Puis le déroulement de cette guerre fut imprévisible pour Poutine, et ses développements internes et internationaux sont encore inattendus pour tous, si ce n’est le danger énorme qu’ils font craindre.
Au lieu de déclencher un processus désintégrateur, l’invasion russe a suscité un processus intégrateur dans la résistance à l’envahisseur ; comme souvent dans !’Histoire, l’ennemi fortifie l’identité d’une nation. La haine de l’ennemi est un ciment d’unité nationale. L’unité ukrainienne est désormais consolidée par le patriotisme grâce à l’invasion ; au lieu d’accentuer les divisions de l’Occident, l’invasion russe les a pour un temps effacées.
Au lieu d’en faire une opération militaire localisée, il a déclenché une guerre économico-politique internationale.
C’est de façon tout à fait continue que le conflit russo-ukrainien est devenu ouvertement un affrontement entre Russie et Occident.
Il est évident que Poutine a pensé décapiter l’Ukraine en lançant son offensive sur la capitale, soit pour y installer un gouvernement fantoche, soit pour l’annexer. S’il avait, selon la thèse russe, contré la préparation d’une attaque ukrainienne sur la région séparatiste, il se serait borné à y déployer ses forces. Or, il est évident que son but initial était annexionniste par la conquête totale de l’Ukraine en frappant sa tête, Kiev. Mais il est non moins manifeste qu’à la suite de son échec, il s’est rabattu sur le Donbass et le Sud maritime, s’emparant de Kherson facilement, rudement de Mykolaïv, et visant Odessa. Mais l’imprévu survint avec les contre-offensives ukrainiennes libérant la région de Kharkiv, reprenant des territoires sur le front du Donbass, délivrant Kherson.
La situation est incertaine, mais il est improbable que la Russie puisse occuper toute l’Ukraine ou que l’Ukraine puisse envahir la Russie.
(…)
Grande est l’urgence : cette guerre provoque une crise considérable qui aggrave et aggravera toutes les autres énormes crises du siècle que subit l’humanité, dont la crise écologique, la crise économique, la crise des civilisations, la crise de la pensée. Qiii elles-mêmes aggravent et aggraveront les maux et la crise issus de cette guerre. Ainsi, il y avait en 2017 quatrevingts millions d’humains au bord de la famine. Puis, après la pandémie, deux cent soixante-seize millions, et actuellement, trois cent quarante-cinq millions.
Plus la guerre s’aggrave, plus la paix est difficile, plus elle est urgente.
Évitons une guerre mondiale. Elle serait pire que la précédente.
(Novembre 2022)
________________________________
Voir la suite :
- Polémiques,
- Et la réaction… Voir l'article ci-joint
03 novembre 2023
La Fabrique du Consommateur, pilier des sociétés marchandes
Notre monde insatiable nous désole chaque jour un peu plus. Mais à qui la faute ? A ces autres consommateurs stupides qui ne sont jamais nous? « Si personne n'achète, ils arrêteront de vendre! » ... n'est-ce pas ? Ce serait donner là bien plus de pouvoir aux individus qu'ils n'en ont vraiment, nous y compris ... Non, la machine du capitalisme est infiniment plus insidieuse. Dans son dernier livre La Fabrique du consommateur, le sociologue Anthony Galuzzo nous offre une analyse au scalpel de l'évolution de notre société entre le XIXe siècle et aujourd'hui. Un voyage dans le temps qui retrace les soubresauts de la société marchande, des premiers échanges d'hier à l'hyperconsommation d'aujourd'hui.
Lumière sur ces invisibles rouages qui nous pourrissent l'existence et la Terre avec.
En 1800, la plupart des français étaient des paysans qui cultivaient leur nourriture, assuraient localement leur existence et fabriquaient leurs propres objets. Leur survie dépendait uniquement du fruit de leur travail. Aujourd'hui, dans nos sociétés industrielles, nous vivons tous entourés d'objets fabriqués par d'autres, composés d'éléments venant majoritairement du bout du monde, dont nous peinons à nous représenter concrètement toutes les étapes de production.
Comment est-on passé d'une société autonome à une société de consommation? Comment cela a-t-il modifié notre rapport aux objets ? Comment ce glissement a-t-il influencé jusqu'à notre organisation sociale? Et pourquoi y reste-t-on coincés à ce point? C'est à l'ensemble de ces questions que le sociologue Anthony Galuzzo entend répondre dans son dernier essai La Fabrique du consommateur publié aux éditions Zones. Une analyse captivante de la mutation progressive de nos sociétés occidentales entre le XIXe et le XXIe siècle.
D'une société autonome et morcelée à l'interdépendance marchande.
Il faut donc se représenter la France du début du XIXe siècle comme un territoire composé de quelques grandes villes et de nombreux villages isolés les uns des autres. Les moyens de locomotion sont lents et l'état des routes rend le transport de marchandises et la communication difficiles "le monde du début du XIXe siècle, s'il faut le comparer à celui qui va naître, est immobile et morcelé" . De cet isolement découle l'obligation pour les français de subvenir à leurs propres besoins. Leur horizon ne dépasse généralement pas le cadre de leur communauté. Le village d'à côté, c'est déjà l'étrange et le lointain.
C'est donc à l'échelle de la communauté que la survie s'organise. On cultive sa propre terre, on fabrique ses propres outils, le plus clair du temps est consacré à cette entreprise de survie. Chaque foyer est un rouage essentiel de la communauté et l'individu se trouve pris dans un grand tout qui le dépasse. L'emprise de la communauté sur l'individu est totale. Les habitants participent de près ou de loin à la production de tous les objets qui les entourent, de tous les produits qu'ils consomment. C'est pourquoi les objets n'existent pas seulement comme objet mais sont pris dans un continuum cohérent allant de la production à la consommation.
La généralisation de la machine à vapeur va renverser la donne. Progressivement, les marchandises circuleront plus rapidement et la communication devient plus aisée. L'homme se rend maître de l'espace et du temps. Il devient désormais rentable de produire à grande échelle, de mettre en place un large réseau commercial pour distribuer sa marchandise sur tout le territoire. Cette nouvelle appréciation de l'espace consacre la domination du marché grâce à son extension exponentielle et irréversible. L'accumulation du capital s'enclenche.
Très vite, le pays tout entier se trouve pourvu en objets manufacturés. On ne cherche plus à produire son moyen de subsistance, mais à devenir soi-même un acteur du marché en vendant sa production. Les villages se spécialisent dans des savoir-faire spécifiques. Une division du travail se met en place à l'échelle hexagonale. Un nouveau rapport s'installe entre les individus et les objets: tantôt producteur, l'individu ne consomme plus ce qu'il produit; tantôt consommateur il ne participe plus à la production de ce qu'il consomme. Un lien se rompt peu à peu entre les Hommes et les objets qui les entourent. Ce sont les premiers balbutiements de la société marchande.
Fétichisation des marchandises : perte de contact avec le coût réel de la matière.
C'est l'un des concepts puissants du texte : ayant perdu de vue l'acte concret de production des marchandises, l'individu ne les perçoit désormais plus que comme simple objet de consommation: l'utilité finale. Auparavant, une table éveillait dans l'esprit de son propriétaire toutes les étapes de fabrication, le maîtrise du bois, le travail collectif qu'elle nécessitait éventuellement et donc les externalités sociales et écologiques des productions. Toute une mystique émanait des objets. La société marchande a détruit ce lien » le produit n'était plus intrinsèquement lié à une origine, à une production[. . .] il devenait un trésor à l'existence magique et spontanée ».
Cette démystification de l'objet permet à la société marchande de redonner un sens à la marchandise, de manière arbitraire et dans une logique purement commerciale : « Les marchands ont, dès lors, le pouvoir d'insuffler[. . .] artificiellement une existence symbolique à leur produit. » En invisibilisant le processus de production, les entreprises ont tout le loisir de resignifier les objets à leur guise, en jouant sur des représentations positives, quand bien même celles-ci entrent en contradiction avec la fabrication de l'objet même. Par ce processus de signification symbolique, la marchandise s'affranchit totalement de sa réalité matérielle.
Cette nouvelle existence symbolique, qui va prendre le pas sur l'existence réelle de l'objet, Anthony Galuzzo l'appelle, à l'instar de Karl Marx, la fétichisation. Un phénomène s'apparentant à l'aura qui recouvre les reliques religieuses : objets matériels certes, mais qui se retrouvent néanmoins augmentés par des considérations religieuses. Par ce processus de ·fétichisation, la valeur symbolique des objets va prendre le pas sur les valeurs d'usage et d'échange, devenant un élément déterminant dans la fixation du prix.
Ville et centre commercial, les temples de la société de consommation.
Dans le développement de la société de consommation, la ville tient une place primordiale. La simplification des déplacements a entraîné une augmentation de la mobilité des individus. L'exode rurale s'intensifie et la population urbaine s'accroît jusqu'à dépasser dernièrement la quantité de personnes sur terre vivant à la campagne.
C'est là que les premiers centres commerciaux voient le jour, à la fin du XIXe siècle. Temple de la consommation, tout y est fait pour faciliter la déambulation détachée et la flânerie. Véritable lieu de sociabilisation, les consommateurs potentiels s'y perdent et se familiarisent avec les marchandises mondialisées, « déambuler entre les marchandises devenait une activité de loisir en soi, un divertissement». Cette contemplation des objets pour le plaisir de la contemplation stimule le caractère mystique de la marchandise dans le regard de l'individu. L'objet n'est plus seulement abordé sous sa valeur d'usage, ou sa valeur d'échange, mais comme une œuvre d'art à apprécier pour elle-même.
Dans ces temples de la consommation, l'abondance est mise en scène à travers une accumulation d'articles variés. Le mode de production est passé sous silence au profit d'une imagerie de l'opulence et du luxe mise en scène dans les décorations de ces grands magasins où les beaux tapis rouges côtoient des ornements en or.
Dans un mouvement contraire, l'acte d'achat est dédramatisé. On peut se balader librement sans acheter, être satisfait ou remboursé. Pour Anthony Galuzzo, c'est dans ces grands magasins que, pour la première fois, la mystification et la mise en scène de la marchandise se conjuguent à une démystification du processus d'achat. Nous vivons à la fois dans une société matérialiste et complètement détachée de la matière.
La marchandise, un outil pour exister socialement
Avec le développement de la presse et de la publicité, les grandes entreprises vont parvenir à accentuer, encore un peu plus, le capital symbolique de leurs marchandises à travers la diffusion d'images. Pour le sociologue, cette valeur symbolique conférée aux objets explique pourquoi la possession devient un moyen d'affirmer son identité. Posséder un objet, c'est posséder les caractéristiques qui l'entourent.
On peut considérer le bourgeois comme la première figure du consommateur
Au début de la société marchande, la première classe à avoir surinvesti les objets d'une valeur symbolique est la bourgeoisie. « On peut considérer le bourgeois comme la première figure du consommateur et la culture matérielle bourgeoise comme étant à l'origine d'une culture de consommation généralisée».
« Je possède donc je suis »
Avec la fin de la société d'ordres, la place qu'on occupe dans la société ne dépend plus d'une filiation séculaire. Néanmoins, l'aristocratie de l'époque reste méprisante à l'égard de cette classe bourgeoise, enrichie depuis peu et nourrissant, à cet égard, une sorte de complexe d'infériorité. C'est par la consommation que le bourgeois fera valoir son rang et sa place dans la société : « La bourgeoisie ainsi méprisée telle une sous-aristocratie, illégitime et vulgaire, doit conquérir sa noblesse par son mode de vie». L'accumulation d'objets devient un moyen de se distinguer de la plèbe, une manière d'exister socialement à travers les objets qui l'entourent. Pour l'auteur, la bourgeoisie cherche à combler un déficit symbolique par un style de vie démontrant sa respectabilité.
Ce réflexe social, aujourd'hui partagé, voilà ce qui a été récupéré par la société marchande à son avantage et continue de l'être. Peut-être ce vampirisme est-il d'ailleurs la plus authentique preuve de la structure prédatrice de notre modèle. Nous nous sommes imaginés tout en haut de la chaîne du vivant, sans même comprendre que nos failles pouvaient être exploitée par d'autres forces que celles que nous connaissions. Loin de l'animal visible dont nous pourrions être la proie consciente et vigilante, notre évolution a laissé apparaître la menace d'un processus qui grandit de nos biais cognitifs et brouille nos perspectives. Si nous sommes à la merci du capitalisme, c'est que nous ne le voyons par principe jamais arriver.
Bien sûr, un travail de déconstruction et de réapprentissage peut permettre d'en sortir, mais l'Histoire collective de notre lourde et lente métamorphose en consommateur complice reste récente, et donc portée par une certaine inertie.
La consommation comme affirmation de soi.
La naissance d'une culture jeune entre 1960 et 1970 répond à une logique similaire d'affirmation de soi. Une période aux perspectives fructueuses pour le monde marchand qui perçoit là un nouveau territoire commercial à conquérir.
En effet, durant les sixties, la jeunesse se rebelle contre l'ordre établi et la rigueur parentale. Le mode de vie rangé de la classe moyenne apparaît repoussant tout en permettant à la jeunesse de jouir d'un pouvoir d'achat nouveau. Ainsi, c'est par la possession d'objets et des habitudes de consommation renouvelées que la jeunesse va se distinguer : musique, vêtement et loisir forment un nouvel archipel de consommation dans lequel la nouvelle génération va puiser les outils pour affirmer une identité singulière.
Le désir de singularité et d'affirmation de soi ne se cantonnent pas à une fracture générationnelle, au sein même de la jeunesse, on assiste à un phénomène de segmentation grâce à la variété des modes. La jeunesse de l'époque ne forme pas une entité homogène, elle est traversée par des courants variés, allant des mouvements hippies aux mods en passant par les rockeurs. Cette complexité est d'autant plus grande aujourd'hui. A chaque courant sa musique, ses codes vestimentaires et ses spécificités. Appartenir à un courant, c'est adopter les habitudes de consommation qui lui correspondent.
On constate le même phénomène dans les mouvements de la contre-culture. En dépit de ses caractéristiques contestataires et ses appels à la marginalisation, la contre-culture sera investie par la société marchande qui utilisera cette fibre révolutionnaire comme argument de vente. C'est par des achats spécifiques que l'on prouvera son esprit de révolte. La généralisation de la tête de Che Guevara sur toute une génération de t-shirts industriels en est l'exemple le plus connu au point où sa symbolique en fut vidée de sa substance.
Pour Anthony Galuzzo, il n'y a pas eu de véritable rupture entre cette époque et la nôtre. En réalité, il s'agit davantage d'un processus évolutif que d'une véritable transformation. Le smartphone n'est que l'aboutissement logique d'un désir de baigner le consommateur dans un océan d'images valorisantes, de faciliter l'achat via le paiement en ligne, d'affermir la valeur symbolique des marchandises par les placements de produits sur les réseaux sociaux. Un processus dont l'auteur nous explique la naissance mais dont il se garde bien d'imaginer l'avenir.
Ce ne sont là que quelques unes des thèses développées dans cet essai d'une richesse exceptionnelle. Loin des discours moralisateurs habituels sur la société de consommation, Anthony Galuzzo nous offre avec son essai une histoire claire et cohérente de la société marchande. Un ouvrage utile pour que chacun repense son rapport aux objets à l'heure où la crise écologique nous invite à plus de mesure.
-T.B.
Infos livre : La Fabrique du consommateur. Anthony Galuzzo aux Editions Zones. ISBN 9782355221422
ISBN numérique 9782355221699.
Maintenant aussi aux Ed. La découverte
version papier 12 €
version numérique 8,99 €
Lire les 25 premières pages sur Calameo : https://www.calameo.com/read/000215022d46beecc8aad
Ed. La découverte
07 janvier 2023
Monica Gagliano - Plant Intelligence and the Importance of Imagination I...
(Possibilité d'activer un sous-titrage en traduction automatique en français (qualité convenable)
Monica Gagliano : La femme qui tendait l'oreille aux plantes
How ‘heretical’ science revealed the intelligence of Nature | Monica Gagliano à Ted-ex
Le récit incroyable d'une biologiste entre découvertes scientifiques et rencontres avec l'esprit des plantes
(Possibilité d'activer un sous-titrage en traduction automatique en français (qualité convenable)
14 octobre 2022
Les ateliers d'auto-description du territoire de Bruno LATOUR

Alors qu'on est entré dans un « nouveau régime climatique», Bruno Latour réunit des citoyens désireux de redéfinir leur territoire, dans des ateliers ou chacun apprend à écouter l’autre. Pionnier de la sociologie des sciences, il estime vivre un moment exceptionnel d'invention et de créativité, et juge urgent de revoir en profondeur notre façon d’aborder les défis de l'époque.
Je reprends ici une partie tout à fait passionnante d’un article paru dans Zadik, où il décrit le processus original de ces ateliers de description du territoire.

ZADIG : Revenons aux ateliers de description du territoire que vous évoquiez. Pourriez-vous nous expliquer en quoi ils consistent et pourquoi vous vous êtes lancé dans cette entreprise ?
B.L.: Je suis un philosophe de terrain. Quand j'ai écrit Où atterrir ? des gens m'ont appelé en me disant:« C'est très bien, mais on fait quoi?» Alors j'ai dirigé avec ma femme Chantal et ma fille Chloé, mais aussi avec des architectes et d'anciens élèves, une « recherche-action » financée par le ministère de l'Environnement pour tester l'idée de cahiers de doléances (11).
En me penchant sur les cahiers de doléances de 1789, j'avais été très frappé - ce qui n'est pas souvent souligné - du fait qu'ils commencent toujours par une description de la paroisse, du terroir ou encore de la corporation, et n'en viennent qu'ensuite à l'énoncé des doléances. Ces descriptions collectives étaient évidemment consignées par des gens qui savaient écrire. Ceux-ci recueillaient les différentes indignations de la paroisse ou de leur corporation, mais les cahiers étaient signés unanimement. Je me suis dit:« Tiens, je vais essayer.»
Je suis donc allé voir mon voisin dans l'Allier, près de Moulins, où je loue une petite maison. Et je me suis aperçu avec grand intérêt que, s'il avait au départ pour ennemis les écologistes, les choses évoluaient tout à fait différemment après quelques heures de discussion, et à la fin, il n'était plus leur ennemi! Il avait resélectionné ses ennemis, en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes retrouvés, au bout du compte, dans ce village de l'Allier, avec un cahier de doléances différent par famille, et même par personne ...
ZADIG : Pour quelles raisons n'avez-vous pas retrouvé l'unanimité de 1789, selon vous ?
B.L.: Parce qu'il n'y a plus aucune espèce de cohésion, parce que les villages ont été complètement mondialisés, avec la présence de néoruraux, de retraités ... Faire des cahiers de doléances unanimes était impossible. Donc, après cette expérience, pour faire en quelque sorte un test, nous avons trouvé, grâce à mon épouse, un premier lieu, à Saint-Junien, dans la Haute-Vienne, puis un deuxième à La Châtre, dans l'Indre. Nous avons réuni un groupe témoin de personnes qu'elle connaissait afin d'essayer, pendant un an et demi, malgré le Covid, de pratiquer ce que j'appelle des« autodescriptions du territoire».
ZADIG : Suivant quels principes avez-vous organisé ces ateliers, et dans quel but ?
B.L.: L'idée n'était pas de discuter. Il fallait s'extraire de la situation actuelle. Nous avons donc dit:« On ne discutera pas, on décrira; et ce n'est pas nous qui allons vous décrire, c'est vous qui le ferez. On prendra le temps qu'il faudra.» Et nous avons accompagné cette pratique d'autodescription, car les gens étaient très tenus dans ces ateliers. Certains sont repartis furieux en disant:« Mais, moi, je suis venu pour discuter, j'ai des tas d'idées», etc
En situation de crise écologique, il s'avère en effet très difficile pour les gens de savoir où ils se situent. Or, si l'on ne sait pas où on se trouve, il est extrêmement complexe de préciser quels sont ses intérêts, ses amis et ses ennemis (pour le dire simplement), et d'exprimer des doléances. La particularité de notre dispositif, assez étrange, c'est que nous avons entièrement filmé nos échanges avant de rédiger un énorme rapport de 400 pages.
ZADIG : Vous avez recouru, en outre, à des formes d'intervention artistique ...
B.L.: Pour arriver à renouveler la question territoriale, nous avons pratiqué en effet, avec un compositeur et une metteuse en scène, des opérations d'expression corporelle, qui sont devenues indispensables du fait de la perte du politique.Je suis depuis des années préoccupé par la disparition du politique. S'il n'est pas entretenu, celui-ci peut disparaître, comme le religieux a disparu. Alors, pour parvenir à reconstituer toutes ses capacités de parole, il faut écouter, laisser les gens s'exprimer. Nous avons donc inventé toute une série de dispositifs. Les témoins de cette expérience ont été très aimables. Ils nous ont supportés pendant un an et demi et ont été transformés par cette expérience de ne pas avoir à discuter.
ZADIG : Comment vous sont apparus les participants à ces travaux ?
B.L. : L'État n'est plus du tout capable de répondre aux demandes. Celles-ci s'adressent à un être tellement abstrait qu'on n'arrive à rien. D'où le profond découragement qu'on a pu voir au moment des Gilets jaunes. Tout mon projet a été autorisé, si j'ose dire, permis par les Gilets jaunes. C'est à ce moment-là que la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, Brune Poirson, m'a appelé et m'a dit: « j'ai lu Où atterrir?, pouvez-vous faire quelque chose pour moi?» Sans elle, on n'aurait jamais eu l'argent pour faire ces ateliers.
ZADIG : Voilà donc une responsable politique qui voulait vraiment comprendre ce qui se passait ...
B.L.: Oui, elle me disait : « Nous sommes complètement hors-sol au ministère.» Cela l'intéressait aussi, de comparer avec l'expérience de la conférence citoyenne sur le climat (12), un autre dispositif grâce auquel l'État soumettait des questions à des gens représentatifs. Alors que nous, ce n'était pas cela du tout: nous travaillions avec trente ou quarante personnes dans deux endroits sur un sujet que ceux-ci considéraient comme vital. Avoir un sujet de préoccupation vital, c'est ça, avoir un territoire.
ZADIG : À l'issue de toutes ces séances, quelles leçons en avez-vous tirées pour construire une action?
B.L.: D'abord, on mesure l'énorme difficulté qu'il y a de pouvoir s'exprimer à nouveau politiquement. Ensuite, avoir l'occasion de parler avec les gens qui ne sont pas d'accord avec vous nécessite un temps extraordinaire. li faut bien se rendre compte que dans une petite ville industrielle comme Saint-Junien, où la ganterie est restée une tradition, on n'est pas isolé. Ce n'est pas du tout un bourg abandonné. Seulement, chaque fois, retrouver le politique demande du temps. Et paradoxalement, pour cela même, il faut contrecarrer la discussion politique, car cette forme d'expression est maintenant en fin de course. Si on n’y prend pas garde, on se retrouve dans une espèce d'indignation, avec des injures ou des demandes qui sont adressées à un État qui n'est pas réel. Et on n'aboutit à rien.
« Il faut absolument arriver à "reterritorialiser" nos analyses, à les faire “atterrir"»
ZADIG: Que vous ont appris les problèmes concrets qui sont remontés?
B.L. : Vous avez une dame qui se trouve dans la désolation. Ce qui la préoccupe - le « caillou dans la chaussure» dont parle John Dewey (13)? Les coupes rases dans sa région. On part de là et on aide la personne à mener sa propre enquête: pourquoi la forêt? Pourquoi les coupes rases? Qui les fait? Quels sont les labels qui permettraient d'offrir une protection? Pourquoi ne sont-ils pas utilisés? Les gens ont enquêté ... Pas toujours de façon très approfondie mais, du moins, certaines recherches ont remonté les chaînes de dépendance qui constituent le territoire. Il était alors intéressant de voir qu'il n'y avait plus de « local », pas plus que de « global » : il n’y avait que des réseaux concrets de connexion. Mais dès qu'on saute au niveau des généralités, qui est celui de la discussion politique ordinaire - par exemple telle qu'elle est répandue sur les réseaux sociaux - on adresse des doléances à un pouvoir qui n'a rien de réel. Il faut donc absolument arriver à « reterritorialiser » nos analyses, à les faire « atterrir».
En un sens, cette expérience nous a prouvé que le projet de notre livre était réalisable. Maintenant, des participants à l'atelier ont repris l'idée, et on mène une autre expérience avec les nouveaux arrivants à Bordeaux. Mais le principe reste le même. Bordeaux est cette fois une grande ville. Ses habitants, qui sont dotés d'un capital culturel plus important, ses élus, tous ont été bouleversés par l'expérience. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient d'une discussion politique. Du coup, ils ont retrouvé des capacités d'expression qui s'étaient perdues dans le brouhaha, sur fond de désespoir et d"indifférence molle.
ZADIG : Avez-vous des exemples de problèmes concrets qui sont ainsi remontés?
B.L.: À Saint-Junien, beaucoup de temps a été consacré à la question de la viande, parce qu'évidemment le Limousin est une région de viande, qui vit essentiellement de l'élevage des vaches; or, un certain nombre de participants étaient végétariens ou essayaient de l'être. Nous avions un couple d'éleveurs absolument formidables, qui nous a beaucoup appris et à qui nous avons pas mal appris aussi. Ils étaient à la FNSEA. mais, en parvenant à admettre l'existence des végétariens, ils ont complètement modifié leur ferme. On a beaucoup travaillé cette question parce que, justement, il y avait derrière toute cette affaire de la refonte de la PAC. La question se posait de façon très simple quand l'agriculteur faisait sa description devant le petit jeune végétarien ...
ZADIG : Vous les aviez donc réunis?
B.L.: C'est ça, l'idée. Tout est collectif, du début à la fin. On n'a pas le droit de discuter les uns avec les autres; en revanche, on écoute l'éleveur décrire son monde en ennemi des écologistes, puis le petit jeune décrire son propre monde ... Nous avons inventé un dispositif un peu théâtral, une boussole, sur laquelle chacun se place (14). On ne cherche pas de réconciliation, mais le déploiement devant le groupe d'un monde contradictoire.
ZADIG: S'écoutent-ils vraiment les uns les autres?
B.L. : On se décrit. on s'écoute soi-même d'abord ! Et les lignes de fracture ont ainsi changé. On s'aperçoit qu'au-delà de la question des écologistes ou des végétariens, c'est l'avenir du Limousin qui se pose s'il n'y a plus que des friches et que les vaches disparaissent ... Cela a pris un an et demi. Il y a eu un essaimage à Ris-Orangis, un autre à Sevran ... Nous ne sommes pas arrivés à des doléances communes, comme je le pensais au début - pour cela, il faudrait des groupes homogènes : les éleveurs du Limousin, ou ceux de Saint-Junien, etc. En revanche, ce que chacun d'eux a fait, c'est creuser ses propres doléances. C'est très intéressant. Par exemple, un éleveur du Jura a commencé à décrire tous les jobs qui pourraient exister par chez lui. On a alors vu que de nombreux métiers seraient possibles dans ces campagnes, à condition d'adopter un autre mode de vie. Et il s'agissait de métiers nouveaux, et non d'un retour aux métiers anciens.
Chacun des participants poursuit donc maintenant sa propre enquête. Nous les suivons parce que nous sommes devenus très amis avec, ils nous ont beaucoup appris. Ce n'est pas encore très abouti, mais nous avons quand même validé un certain nombre d'hypothèses. Quand nous avons essayé d'organiser des ateliers avec les administrateurs des territoires, nous nous sommes aperçus qu'ils étaient pas mal perdus, eux aussi.
ZADIG : .A qui pensez-vous exactement et pourquoi dites-vous qu'ils sont perdus ?
.png) | |
| image Serge Bloch, auteur-illustrateur, ZADIK le mag |
B.L :Je pense aux services délocalisés de l'Etat. lis ne voient plus les habitants. n'en ont plus le temps et même plus le droit parce qu'ils sont juste en contact avec les communautés de communes. Ils sont en plus dans une situation de détresse très profonde.Je n'imaginais pas me retrouver dans une campagne où les services de l'État chargés de ces questions ne sont plus présents. Il est vrai que c'est compliqué maintenant: les territoires sont tellement dispersés, les géographes le montrent depuis longtemps ... Mais qu'un petit village ne puisse pas imaginer une simple réunion pour que s'expriment les doléances communes, c'est quand même très troublant.
ZADIG : Pensez-vous que les politiques qui ont pris connaissance de tout ce travail vont essayer d’agir, justement ?
B.L: Non. parce que ce n'est pas “actionnable”: on ne peut rien en tirer du point de vue pratique, ce n'est pas le but d’ailleurs. Curieusement. ce qui a retenu leur attention, c'était précisément qu'on leur offrait non pas une étude sur un territoire. mais des gens qui se posaient leurs propres questions. Cela les a beaucoup intéressés - pas tellement les politiques, mais du moins les administrateurs. L’autre chose qui leur a plu. ce sont les activités artistiques. Alors qu'au début, quand on a proposé ce projet, l'idée que soient présents un compositeur et des « thèâtreux » leur paraissait étrange, ils ont finalement trouvé cela passionnant.
“Quelles frontières pour un État moderne capable d'aborder la question écologique ?”
ZADIG : vous disiez tout à l'heure qu’un territoire n'existe pas en tant que tel; mais à travers un réseau de dépendances. Pour agir dans le domaine de l'écologie. pour le climat, la France, en tant qu'entité, peut-elle quelque chose ou est-elle trop dépendante d'éléments extérieurs ?
B.L :Je ne suis pas vraiment politiste. Quelles frontières pour un Etat moderne capable d'aborder la question écologique? C'est une immense interrogation. L'expérience européenne est parmi les plus intéressantes qui soient. L'Europe, par se taille et par l'intrication des questions qui y sont traitées, peut être une réponse. Mais quelle serait la logique administrative qui permettrait de suivre la variation d'échelle des sujets de controverse ? Ce n'est pas une question simple. Si vous prenez l'histoire des néonicotinoïdes dans le traitement de la betterave (15), vous allez être confronté à des problèmes qui se situent à des échelles très différentes, parfois d'ailleurs au niveau de Bruxelles .. On est donc à la recherche d'une autre définition du territoire. qui abandonne l'opposition “local-global” et la remplace par une attention aux connexions, aux opérations d'attachement et de dépendance. Est-ce que ça modifie la carte administrative de la France? Oui. évidemment puisqu'elle date de la Révolution française pour le département puis de la modernisation de l'après-guerre. Or, on n'est plus face aux mêmes enjeux. Il va donc bien falloir se poser la question du territoire national.
ZADIG : Cette carte de France est-elle aujourd'hui à ce point inopérante au regard des enjeux écologiques ?
B.L: En tout cas, son inadéquation est une des raisons pour laquelle les gens ne savent pas où se situer, “où atterrir”. Mon hypothèse générale, c'est qu'il ne sert à rien de vouloir “changer les mentalités”. Si ces mentalités existent c'est justement parce que le monde est devenu tellement différent qu'il n'est plus descriptible: on est dans l'indignation, dans la peine, dans l’embarras. mais plus dans l'action. Ce qui est tout à fait passionnant dans notre étude, c'est de pouvoir observer concrètement la manière dont les gens se transforment, la façon qu'ils ont de reprendre pied. alors que la situation reste aussi horrible qu'avant. Ils n'ont pas résolu le problème, mais ils sont en puissance d'agir. Après tout, on a inventé l'État moderne. on pourrait donc bien le “désinventer” pour imaginer autre chose. On est au milieu de la bataille.
“La division entre géographies physique et humaine a été une immense catastrophe. le manuel de terminale est un scandale absolu”
ZADIG : Quelles sont les disciplines auxquelles il conviendrait de faire appel pour résoudre ces questions ?

B.L: Sur ces sujets de territoire. je fais d'abord appel aux sciences. Qu'est-ce que c’est un territoire? De quoi est-il fait matériellement? Mais la division entre géographie physique et géographie humaine a été une immense catastrophe déjà là derrière moi {dans sa bibliothèque, ndlr}. le manuel de géographie de terminale: c'est un scandale absolu, il s'agit d'un livre sur l'expansion spatiale du capitalisme, l'histoire des conteneurs ... Il n'y a aucune géographie physique dedans. J’exagère à peine. Or, c'est l'enseignement qu'on donne aux terminales en ce moment. C'est quand même assez surprenant.
Cette coupure en deux affecte aussi les sciences traitées dans un autre cours, celui des sciences de la Terre. Or, celles-ci, avec l'étude du climat et l'apparition de la notion de zone critique (16), se sont tout à fait renouvelées dans les trente dernières années. Il faut observer dans toutes leurs dimensions concrètes: le cycle du carbone, suivre comment les rivières transportent les produits chimiques, savoir ce que c'est qu'un sol, un humus, etc., sinon vous êtes dans un monde qui est une abstraction. On devrait aussi s'appuyer sur les arts, arriver à mettre en relation des scientifiques spécialistes de la terre avec des artistes. pour renouveler nos façons de voir (17). Il faudrait refaire ce qu'a été la grande géographie française au XIXe siècle. mais qui a été complètement abandonné au XXe. La priorité, pour moi, c’est cette science des vivants, d'un monde construit par les vivants. À mon avis, cela changerait beaucoup de choses. Mais j'ai encore de la peine à convaincre…
ZADIG : Pensez-vous que votre formation et vos réflexions philosophiques ont aujourd’hui pris une valeur nouvelle ? Est-ce que, comme philosophe, vous étiez préparé à ces nouveaux impératifs écologiques et climatiques ?
B.L: Un des éléments essentiels, et qui est toujours: oublié, c'est qu'il faut s'intéresser aux sciences dans leur pratique et non dans leur idéologie. Voilà ce que j'ai fait pendant vingt-cinq ans. Ensuite, j’ai travaillé sur la théorie sociale : de quelles associations une société est-elle composée? Cela fait quand même quarante ans que mes amis et moi. nous travaillons ces questions. Je n'ai pas: été particulièrement en avance sur celle de l’écologie, mais il y avait des gens bien plus informés que moi depuis bien plus longtemps - notamment Michel Serres (
18). dont j’ai été l'ami. On avait les outillages nécessaires. C'est d'ailleurs l’objet du petit mémo que je viens de publier avec Nikolaj Schultz. Mémo sur la nouvelle classe écologique.
ZADIG : Après avoir grandi en province et vécu à l'étranger, vous résidez depuis longtemps à Paris. Vous êtes-vous attaché à cette capitale aussi ?
Je n’ai pas d’attaches à Paris…
(...)
« Je n'ai pas vécu de période plus riche intellectuellement et artistiquement que maintenant »
ZADIG : L'opposition entre Paris et la province continue-t-elle selon vous d avoir du sens?
B.L.: Je ne peux pas vraiment vous répondre. La seule chose qui me stupéfie, chaque fois qu'on est en province, c'est le nombre de personnes intéressantes et l'incroyable richesse des gens. Prenez Saint Julien, c'est un endroit passionnant, avec des innovateurs de tous les côtés; à Bordeaux, mais aussi à Toulouse ou à Grenoble, là où l'on fait nos ateliers, c'est inouï le nombre de gens intéressants.
La superstructure médiatique et académique a beaucoup de difficultés à appréhender cela. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas de liens intellectuels en France, c'est une erreur absolue. On parle de dépression, de l'extrême droite ... Mais moi, je n'ai pas vécu de période plus riche intellectuellement et artistiquement que maintenant. Les années 1960 furent des années sinistres, il ne faut pas l'oublier. Il y avait bien sûr Foucault, Deleuze ... mais il y avait les communistes partout, une interdiction de parole complète, une gauche militante totalement fermée ... La France doute d'elle-même alors qu'elle est dans une période de création, d'innovation intense, de réflexion ahurissante. Évidemment, le système académique n'enregistre pas cela. Mais le nombre de gens que je connais qui travaillent sur ce sujet et qui n'ont pas de job permanent, je les compte sur les doigts de plusieurs mains. C'est un vrai problème. Je sais, par mes travaux à Sciences Po, la difficulté qu'il y a dire : « Ce sont des sujets fondamentaux. Il y a plein de gens intéressants, embauchez-les ! »
ZADIG : Est-ce un manque de curiosité, de prise de conscience?
B.L.: C'est l'idée, fausse, que les questions écologiques sont des questions à part et non des questions centrales pour l'ensemble des disciplines. Pourtant, elles sont cruciales pour la sociologie, pour le droit, pour la littérature, pour la politique, pour la religion ... La question écologique n'est pas un sujet de plus.
________
NOTES
11. Un travail entrepris en parallèle des « cahiers: de doléances » mis à disposition dans les mairies, lors. de la consultation nationale décidée après. le mouvement des Gilets jaunes, initiative qu'il jugeait insuffisante.
12. Assemblée de 150 citoyens tirés au sort, constituée à la demande du gouvernement en 2019 afin de définir des mesures structurantes pour réduire les émissions de C02 nationales. Elle rendit, en 2020, 149 propositions, mais jugea sévèrement leur faible application.
13. Dans le Public et ses problèmes (1927) le philosophé américain (1859-1952) écrivait:« C'est la personne qui porte la chaussure qui sait le mieux si elle fait mal et où elle fait mal, mème si le cordonnier est l'expert qui est le meilleur juge pour savoir comment y remédier.»
14. Le participant se place au centre d'un cercle trad au sol. Derrière lui, à sa droite, ce qui le fait vivre ; à sa gauche, ce qui le menace. Devant lui, à droite, ce qui améliore ses « conditions d'habitabilité»; à gauche, ce qui les détériore. S'ensuit un “exercice d’autodescription" pour nommer ces éléments.
15. Dont la réautorisation temporaire par dérogation, notamment pour lutter contre l'émergence massive de la jaunisse de la betterave, fait polémique.
16. Fine pellicule de la planète comprise entre la basse atmosphère et le sous-sol, où se concentre la vie. Elle joue un grand rôle dans la régulation du Système Terre et de ses cycles biochimiques (énergie, carbone ... ), qui influencent le climat. Son étude implique de ne pas séparer activités humaines et naturelles.
17. C'était l'objet de l'exposition « Critical Zone: Observatories for Earthly Politics », organisée par Bruno Latour et l'artiste autrichien Peter Weibel au Center for Art and Media de Karlsruhe, en Allemagne, de mai 2020 à septembre 2022.
18. Bruno Latour a publié en 1992 ses entretiens avec le philosophe des sciences (1930-2019), intitulés Éclaircissements.
__________
Lire l'article entier dans le magazine ZADIK (en pdf) ou dans mes "peartrees"
______________________________
Voir aussi les vidéos enregistrées par Bruno Latour sur Arte :




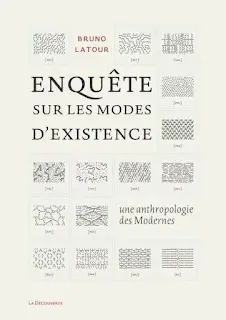
.png)
